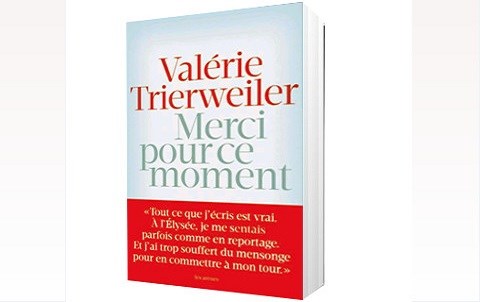
A la lecture du livre «Merci pour ce moment» de Valérie Trierweiler, ex-compagne du Président français, François Hollande, on constate qu’il s’agit d’abord du récit –poignant- d’une rupture. Une rupture inattendue, douloureuse, lente. Tout le reste est une sorte de flashs back de l’auteure renvoyant à sa vie d’avant, pendant et après sa liaison de 9 ans avec François Hollande. Les allers retours, entre la femme qui se sent trahie et jetée et la journaliste qui livre sa vie et les réflexions que lui inspire son vécu, sont nombreux et portent aussi bien sur sa vie privée que sur la vie politique française. Mais c’est cette histoire d’amour, intense, déchirante et d’actualité brûlante qui émeut, voire touche aux larmes.
C’est ce que ces «Bonnes feuilles» retiennent.
Ce que nous proposons à nos lecteurs n’est qu’une sorte de mise en bouche invitant à la lecture de ce livre (Editions les arènes) qui a fait le buzz et que nous avons lu avec autant d’émotion que de plaisir. Il se lit d’une traite et, bien que l’histoire soit personnelle, on n’en sort pas indemne.
BA
Pourquoi écrit-elle ce livre…
En quelques heures de janvier 2014, ma vie a été dévastée et mon avenir a volé en éclats. Je me suis retrouvée seule, étourdie, secouée de chagrin. Il m’est apparu comme une évidence que la seule manière de reprendre le contrôle de ma vie était de la raconter. J’ai souffert de ne pas avoir été comprise, d’avoir été trop salie.
J’ai donc décidé de briser ces digues que j’avais construites, et de prendre la plume pour raconter mon histoire, la vraie. Alors que je n’ai cessé de combattre pour protéger ma vie privée, il me fallait en livrer une partie, donner quelques clés sans lesquelles rien n’est compréhensible. Dans cette histoire folle, tout se tient. Et j’ai trop besoin de vérité, pour surmonter cette épreuve et aller de l’avant. Je le dois à mes enfants, à ma famille, aux miens. Écrire est devenu vital.
L’épisode douloureux de Closer
Le premier message me parvient le mercredi matin. Une amie journaliste m’alerte: « Closer sortirait vendredi en une des photos de François et de Gayet ». Je réponds laconiquement, à peine contrariée. Cette rumeur m’empoisonne la vie depuis des mois. Elle va, vient, revient et je n’arrive pas à y croire. Je transfère ce message à François, sans commentaire. Il me répond aussitôt :
– Qui te dit ça ?
– Ce n’est pas la question, mais de savoir si tu as quelque chose à te reprocher ou non.
– Non, rien.
Me voilà rassurée.
Au fil de la journée, la rumeur continue cependant d’enfler. François et moi parlons l’après-midi et dînons ensemble sans aborder le sujet. Cette rumeur a déjà été l’objet de disputes entre nous, inutile d’en rajouter.
Le lendemain matin, je reçois un nouveau texto d’un autre ami journaliste : « Salut Val. La rumeur Gayet repart, elle serait en une de Closer demain, mais tu dois déjà être au courant ». Je transfère à nouveau le message à François. Cette fois-ci, pas de réponse. Il est en déplacement près de Paris, à Creil, auprès des armées.
Je demande à un de mes vieux copains journaliste, qui a gardé des contacts au sein de la presse people, de sortir ses antennes. Les coups de fil en provenance des rédactions se multiplient à l’Élysée. Tous les conseillers en communication de la Présidence sont pressés de questions par les journalistes sur cette couverture hypothétique.
La matinée se passe en échanges avec des proches. Il est prévu que je rejoigne l’équipe de la crèche de l’Élysée autour d’un repas, préparé par le cuisinier des petits.
Nous avons initié ce rituel l’année passée. Une douzaine de femmes s’occupent des enfants du personnel et des conseillers de la Présidence. Un mois plus tôt, nous avons fêté Noël ensemble, avec les parents de la crèche. François et moi avons distribué les cadeaux, lui était parti vite, comme à chaque fois, j’étais restée un long moment à discuter avec les uns et les autres. Heureuse dans ce havre de paix.
Ce déjeuner me réjouit, mais je me sens déjà oppressée, comme à l’approche d’un danger. La directrice de la crèche nous attend à la porte, de l’autre côté de la rue de l’Élysée. Patrice Biancone, un ancien confrère de RFI devenu mon fidèle chef de cabinet, m’accompagne. En arrivant, je retire de ma poche mes deux téléphones portables : l’un pour le travail et la vie publique ; l’autre pour François, mes enfants, ma famille et mes amis proches. La table a été dressée comme pour un jour de fête, les visages sont joyeux.
Je masque mon malaise et glisse mon téléphone privé près de mon assiette. « Fred », le cuisinier, nous apporte ses plats, tandis que les assistantes maternelles alternent autour de la table, afin de se relayer auprès des petits.
En 2015, la crèche de l’Élysée va fêter ses trente ans. Elle a accueilli près de six cents enfants, notamment ceux du Président lorsqu’il était conseiller à l’Élysée. Pour célébrer cet événement, j’ai le projet de réunir les anciens bébés devenus grands. Journaliste à Paris-Match depuis vingt-quatre ans, j’imagine sans peine la jolie photo que peut donner ce rassemblement dans la cour de l’Élysée. Nous voulons baptiser la crèche du nom de Danielle Mitterrand, qui l’a créée en octobre 1985. Désormais ambassadrice de la fondation France Libertés, je prends en charge cet anniversaire. Je promets de faire une note rapidement à Sylvie Hubac, la directrice de cabinet de François Hollande, pour valider le projet et obtenir un budget.
Le téléphone vibre. Mon ami journaliste est allé « à la pêche aux infos » et me confirme la sortie de Closer avec en une la photo de François, en bas de chez Julie Gayet.
Mon coeur explose. J’essaie de ne rien montrer. Je tends mon téléphone à Patrice Biancone, afin qu’il lise le message. Je n’ai aucun secret pour lui : « Regarde, c’est au sujet de notre dossier. » Le ton de ma voix est le plus plat possible. Nous sommes amis depuis près de vingt ans, un regard suffit à nous comprendre. Je prends un air détaché :
« Nous verrons ça tout à l’heure. »
Je m’efforce de revenir à la conversation avec les membres de la crèche, alors que les pensées s’entrechoquent dans mon esprit. Nous en sommes à l’épidémie de varicelle.
Tout en hochant la tête, je préviens François par sms de l’information de Closer. Ce n’est plus une rumeur, mais un fait.
– Voyons-nous à 15 heures à l’appartement, me répond-il aussitôt.
C’est l’heure de prendre congé de la directrice de la crèche. Une rue, une toute petite rue à traverser. C’est la route la plus périlleuse de toute ma vie. Bien qu’aucune voiture non autorisée ne puisse l’emprunter, j’ai le sentiment de traverser une autoroute les yeux fermés.
Je gravis rapidement l’escalier qui mène à l’appartement privé. François est déjà dans la chambre, dont les hautes fenêtres donnent sur les arbres centenaires du parc. Nous nous asseyons sur le lit. Chacun du côté où nous avons l’habitude de dormir. Je ne peux prononcer qu’un seul mot :
– Alors?
– Alors, c’est vrai, répond-il.
– C’est vrai quoi? Tu couches avec cette fille?
– Oui, avoue-t-il en s’allongeant à demi, appuyé sur son avant-bras.
Nous sommes assez près l’un de l’autre sur ce grand lit. Je n’arrive pas à accrocher son regard, qui se dérobe. Les questions se bousculent :
– Comment c’est arrivé? Pourquoi? Depuis quand?
– Un mois, prétend-il.
Je reste calme, pas d’énervement, pas de cris. Encore moins de vaisselle cassée comme la rumeur le dira ensuite, m’attribuant des millions d’euros de dégâts imaginaires.
Je ne réalise pas encore le séisme qui s’annonce. Peut-il laisser entendre qu’il est seulement allé dîner chez elle? Je le lui suggère. Impossible, il sait que la photo a été prise au lendemain d’une nuit passée rue du Cirque. Pourquoi pas un scénario à la Clinton? Des excuses publiques, un engagement à ne plus la revoir. Nous pouvons repartir sur d’autres bases, je ne suis pas prête à le perdre.
Ses mensonges remontent à la surface, la vérité s’impose peu à peu. Il admet que la liaison est plus ancienne. D’un mois, nous passons à trois, puis six, neuf et enfin un an.
– Nous n’y arriverons pas, tu ne pourras jamais me pardonner, me dit-il.
Puis il rejoint son bureau pour un rendez-vous. Je suis incapable d’honorer le mien, je demande à Patrice Biancone de recevoir mon visiteur à ma place. Je reste cloîtrée tout l’après-midi dans la chambre. J’essaie d’imaginer ce qu’il va se passer, rivée à mon téléphone portable, guettant sur Twitter les prémices du scoop annoncé. Je tente d’en savoir plus sur la tonalité du « reportage ». J’échange par sms avec mes plus proches amis, je préviens chacun de mes enfants et ma mère de ce qui va sortir. Je ne veux pas qu’ils apprennent ce scandale par la presse. Ils doivent se préparer.
François revient pour le dîner. Nous nous retrouvons dans la chambre. Il semble plus abattu que moi. Je le surprends à genoux sur le lit. Il se prend la tête entre les mains. Il est dans un état de sidération :
– Comment allons-nous faire?
Il utilise furtivement le « nous » dans une histoire où je n’ai plus guère ma place. C’est la dernière fois, bientôt seul le « je » comptera. Puis nous tentons de dîner dans le salon, sur la table basse, comme nous le faisons lorsque nous cherchons un peu plus d’intimité ou quand nous voulons abréger les repas.
Je ne peux rien avaler. J’essaie d’en savoir plus. Je passe en revue les conséquences politiques. Où est le Président exemplaire? Un président ne mène pas deux guerres tout en s’évadant dès qu’il le peut pour rejoindre une actrice dans la rue d’à côté. Un président ne se conduit pas comme ça quand les usines ferment, que le chômage augmente et que sa cote de popularité est au plus bas. À cet instant-là, je me sens davantage atteinte par le désastre politique que par notre faillite personnelle. Sans doute ai-je encore l’espoir de sauver notre couple. François me demande d’arrêter cette litanie de conséquences désastreuses; il sait tout cela. Il avale quelques bouchées et retourne dans son bureau.
Choc et hospitalisation
Me voici à nouveau seule avec mes tourments, alors qu’il a convoqué une réunion dont j’ignore tout. « On » va parler de mon sort, sans que je sois tenue au courant ni de qui ni de quoi. À 22h30, il revient. Il ne répond pas à mes questions. Il paraît perdu, déboussolé. Je décide d’aller voir Pierre-René Lemas, le secrétaire général de l’Élysée, que je préviens par téléphone. François me demande ce que je lui veux.
– Je ne sais pas, j’ai besoin de voir quelqu’un.
À mon tour d’emprunter ce petit couloir quasi secret qui relie l’appartement privé et l’étage présidentiel. À mon arrivée, Pierre-René ouvre grand ses bras. Je m’y réfugie. Pour la première fois, je m’effondre en larmes et c’est contre son épaule. Il est comme moi, ne comprend pas comment François a pu se lancer dans pareille histoire. Contrairement à beaucoup d’autres conseillers, Pierre-René a toujours été bienveillant. Depuis presque deux ans, il a souvent subi les accès de mauvaise humeur de François dans la journée. Le soir, c’était à mon tour de servir de paratonnerre. Nous nous soutenions l’un l’autre. Nous échangeons quelques mots. Je lui explique que je suis prête à pardonner. J’apprendrai ensuite qu’un communiqué de rupture a déjà été évoqué lors de cette première réunion.
Mon sort est scellé, mais je ne le sais pas encore.
Retour à la chambre. Une longue nuit quasi blanche commence. Avec toujours les mêmes questions qui tournent en boucle. François avale un somnifère pour échapper à cet enfer et dort quelques heures à l’autre bout du lit. À peine une heure de sommeil et je me lève vers 5 heures pour regarder les chaînes d’info dans le salon. Je grignote les restes froids du dîner, laissés sur la table basse, et enchaîne sur l’écoute des radios.
« L’information » est le premier titre des matinales. Les évènements deviennent subitement concrets. La veille encore tout me semblait irréel.
François se réveille. Je sens que je ne vais pas y arriver. Je craque, je ne peux pas entendre ça, je me précipite dans la salle de bains. Je saisis le petit sac en plastique, caché dans un tiroir au milieu de mes produits de beauté. Il contient des somnifères, plusieurs sortes, sous forme liquide ou en pilules. François m’a suivie dans la salle de bains. Il tente de m’arracher le sac. Je cours dans la chambre. Il attrape le sac qui se déchire. Des pilules s’éparpillent sur le lit et le sol. Je parviens à en récupérer quelques-unes.
J’avale ce que je peux. Je veux dormir, je ne veux pas vivre les heures qui vont arriver. Je sens la bourrasque qui va s’abattre sur moi et je n’ai pas la force d’y résister.
Je veux fuir d’une façon ou d’une autre. Je perds connaissance. Je ne pouvais pas espérer mieux.
Je n’ai aucune idée du temps pendant lequel j’ai dormi. Sommes-nous le jour? La nuit?
Que s’est-il passé ? Je sens qu’on me réveille. J’apprendrai ensuite que nous sommes en fin de matinée. Au-dessus de moi, comme à travers une nappe de brouillard, j’aperçois le visage de deux de mes meilleurs amis, Brigitte et François. Brigitte m’explique que je peux être hospitalisée, qu’elle a préparé ma valise. Dans la pièce d’à côté, deux médecins attendent. Olivier Lyon-Caen, le conseiller santé à l’Élysée, a pris les choses en main et appelé le professeur Jouvent, qui dirige le service de psychiatrie de la Pitié-Salpêtrière.
L’un et l’autre me demandent si je suis d’accord pour être hospitalisée. Que faire d’autre?
J’ai besoin qu’on me protège de cet ouragan même si, à cet instant, je sais à peine qui je suis et ce qu’il se passe. Je n’y arriverai pas seule.
Je demande à voir François avant de partir, l’un des médecins s’y oppose. Je trouve la force de dire que je ne partirai pas sinon… On va le chercher. Lorsqu’il apparaît, je reçois un nouveau choc. Mes jambes se dérobent, je m’écroule. Le voir me renvoie à sa trahison.
C’est encore plus violent que la veille. Tout s’accélère. La décision de m’emmener est prise aussitôt.
Je suis incapable de tenir debout. Les deux officiers de sécurité se placent chacun d’un côté, m’empoignent sous les bras et me soutiennent autant qu’ils le peuvent. L’escalier paraît interminable. Brigitte suit avec mon sac, un joli sac que l’équipe qui travaille avec moi à l’Élysée m’a offert pour les voyages officiels à l’occasion de mon anniversaire. Mais nous sommes loin de l’apparat des réceptions. La première dame ressemble à une poupée de chiffon disloquée, incapable de se tenir debout, ni de marcher droit. Brigitte m’accompagne en voiture. Je reste silencieuse tout au long du chemin. Impossible de parler.
Je suis prise en charge dès mon arrivée et installée en un rien de temps dans un lit d’hôpital. Mais quel cauchemar m’a donc conduite là, perfusée et revêtue d’une chemise de nuit de l’Assistance publique ? Plongée dans un sommeil profond. Combien de temps :
Un jour, deux jours? Je ne sais pas, j’ai perdu toute notion d’horloge. Mon premier réflexe au réveil est de me précipiter sur mes deux téléphones portables. Ils sont introuvables.
Le médecin m’explique qu’on me les a confisqués « pour me protéger du monde extérieur ».
J’exige de les récupérer, je menace de partir. Devant ma détermination, les médecins acceptent de me les rendre.
Je vois débarquer dans ma chambre, en blouse blanche, l’officier de sécurité qui m’accompagne depuis l’élection du Président. Pour plus de discrétion, il est installé sur une chaise à l’entrée de ma chambre, déguisé en infirmier. C’est lui qui veille sur les visites autorisées ou non. Elles sont rares. J’ignore encore que tout est sous contrôle. Et pas sous le mien. Cette affaire personnelle est traitée comme une affaire d’État. Je ne suis plus qu’un dossier.
Je confirme à un journaliste l’information de mon hospitalisation. Je sens qu’il se passe quelque chose du côté de l’Élysée. Mon impression se vérifie. Aussitôt la nouvelle connue, « ils » veulent me faire sortir. La première dame à l’hôpital, ce n’est pas bon pour l’image du Président. D’ailleurs pas grand-chose n’est bon pour son image dans cette histoire. Et surtout pas cette photo de lui prise rue du Cirque avec son casque sur la tête. Cette fois, je résiste et déclare au médecin que je veux rester encore quelques jours. Où aller?
Rentrer rue Cauchy, chez moi, chez nous? Je suis tellement shootée que je ne tiens pas debout, ma tension est descendue à 6. Un jour, elle est tellement basse qu’elle ne peut même plus être mesurée.
Les médecins parlent de m’envoyer dans une clinique de repos. Mes souvenirs sont flous.
Je revois les infirmières qui viennent prendre ma tension très régulièrement, y compris la nuit en me réveillant. Je ne me souviens pas de toutes les visites, sauf évidemment de celles de mes fils qui, chaque jour, m’apportent des fleurs et des chocolats, ou de ma mère aussi, venue en catastrophe de province. Et de François, mon meilleur ami, qui lui aussi vient tous les jours. Brigitte, elle, fait le lien avec l’Élysée. Elle me dira par la suite qu’elle a été sidérée par l’inhumanité qu’elle a rencontrée. Un mur.
Toujours pas de visite de François au cinquième jour, même s’il m’envoie des messages quotidiens assez laconiques. J’apprends que les médecins lui ont interdit de venir me voir.
Je ne comprends pas cette décision qui, en plus d’être blessante pour moi, est désastreuse sur le plan politique. Après une discussion houleuse, le médecin cède à mes arguments et lève l’interdiction. Il autorise une visite de dix minutes. Elle dure plus d’une heure.
Là encore mes souvenirs sont vagues. La discussion est apaisée. Peut-il en être autrement avec la dose astronomique de tranquillisants qu’on m’administre?
(…) Trois mois après ma sortie de l’hôpital, le 24 mars, le jour du premier tour des municipales de 2014, je me réveillerai en pleurs. Ne pas être avec lui ce jour-là sera une douleur. Cette échéance électorale réveillera mes souvenirs, le bonheur que j’avais à vibrer avec lui lors de ces moments si particuliers, pour chaque élection comme lors des retrouvailles de l’université d’été du PS à La Rochelle.
Une semaine après sa sortie de l’hôpital, alors qu’elle est en convalescence dans un domaine dépendant de la présidence «La Lanterne», Valérie Trierweiler reçoit la visite de François Hollande. Un autre moment de douleur qu’elle raconte.
François et moi nous retrouvons l’un en face de l’autre, chacun assis sur un canapé différent. Ils ont beau être fleuris, l’ambiance est pesante, la distance est déjà palpable.
C’est alors qu’il me parle de séparation. Je ne comprends pas la logique des choses. C’est lui qui est pris sur le fait et c’est moi qui paie les pots cassés, mais c’est ainsi. Sa décision ne semble pas encore irrévocable, mais je n’ai pas la force d’argumenter. Il tente de se montrer le moins dur possible mais la sentence est terrible. Je ne réalise pas vraiment, je suis comme anesthésiée.
Nous rejoignons la salle à manger pour le dîner. Avec la présence des maîtres d’hôtel, la conversation devient presque banale. Nous allons nous coucher, chacun dans une chambre différente. Cela ne nous était jamais arrivé. Cette fois, il veut marquer la fin. Ma nuit est agitée de cauchemars et d’hallucinations, sous l’effet des médicaments. Je me réveille en sursaut, convaincue que quelqu’un est dans la pièce. Je pense à François ouvrant ses bras à une autre femme. Qui a fait le premier pas? Que lui a-t-il dit de nous?
Que cherchait-il chez elle que je ne peux pas lui donner ? Les images me blessent, je les repousse, mais elles remontent, encore et encore. Elles m’étouffent et je m’étrangle dans mes sanglots.
Le matin, il me précise qu’il partira après le déjeuner et que deux de mes très proches amies, Constance et Valérie, veulent venir me voir. Pourquoi ne m’appellent-elles pas directement ? Je préfère être seule, pour me retrouver et affronter ce qui arrive.
François insiste. Il n’assume pas de me laisser face à mon désespoir alors qu’il s’apprête à rejoindre sa maîtresse.
Nous avons prévu de nous revoir, lui et moi, le jeudi suivant. Le jeudi a toujours été notre jour, celui du début de notre relation amoureuse, celui des rendez-vous entre 2005 et 2007. Et celui de la fameuse chanson de Joe Dassin, que nous avons écoutée en boucle tant de fois dans ma voiture en chantant : « Souviens-toi, c’était un jeudi/Le grand jour/Le grand pas vers le grand amour ».
Je prends l’initiative de lui donner rendez-vous rue Cauchy, à notre domicile. Nous y serons seuls pour parler librement. Il arrive à l’heure, ce n’est pas dans ses habitudes. Il a apporté le déjeuner préparé par l’Élysée, un caisson en fer-blanc avec des assiettes garnies, qu’il suffit ensuite de glisser dans le micro-ondes.
Ses officiers de sécurité restent en bas de l’immeuble. Depuis la publication des photos de Closer où on les voit apporter un sachet de croissants rue du Cirque au petit matin, ils savent qu’ils n’ont pas intérêt à me croiser.
Tout cela est irréel, nous mettons la table comme un couple ordinaire, sans appétit. À la fin, comme si rien n’avait changé, il se lève et prépare les cafés avant de nous installer au salon. C’est le moment d’évoquer les questions matérielles.
(…) Allumer mon ordinateur, me trouver face à la page blanche, seule avec moi-même, me déconnecter du monde, me concentrer, voilà qui m’a aidée à traverser bien des épreuves.
Mais pas celle-là.
En ce jeudi si sombre où François me quitte, je serai incapable de me concentrer sur plus de deux lignes d’un livre. J’assiste impuissante à la fin de notre couple. Le Président m’assure que je n’ai pas de souci à me faire, que j’aurai sûrement des propositions professionnelles qui me permettront de repartir dans la vie.
Après avoir abordé la question financière, il évoque tous les points qui le préoccupent.
Il veut que j’abandonne l’idée d’écrire un livre, une idée qui s’impose à moi depuis quelques jours et dont je lui ai parlé. Il n’est pas question de me faire renoncer à quoi que ce soit qui concerne « ma vie d’après lui ». Il insiste pour que nous annoncions « notre » séparation par un communiqué commun. Je refuse. Cette rupture, je n’en veux pas. Elle n’a rien de commun. Il me l’impose. Le ton est calme, froid. Tout est si triste.
La rupture ne se fera pas en une seule fois. Pour V. Trierweiler, la torture continue…
Ce samedi 25 janvier, mon coeur se serre. Cette fois, c’est la fin. En arrivant dans l’appartement privé, je commence par rassembler les tenues dont j’aurai besoin pour l’Inde, puis je préviens François par sms que je suis là. Nous nous retrouvons, une fois de plus, dans une atmosphère lourde, assis chacun à notre place habituelle dans le salon. Il insiste encore pour le communiqué commun. Je refuse à nouveau, exposant toujours les mêmes arguments. Nous rejouons la scène.
Il me demande une fois de plus de renoncer à l’Inde :
– Tu auras tous les journalistes.
Il s’apprête à me répudier et la seule chose qui lui importe est que la presse le suive, lui et pas moi.
– Et alors ? J’en aurai peut-être plus que toi en Turquie.
C’est dérisoire, mais je cherche à le provoquer. Il s’inquiète de ce que je leur dirai.
– Je ne sais pas encore.
Il est assis, mal à l’aise, un petit papier à la main. Il me lit le communiqué de rupture qu’il a prévu de livrer à l’AFP, dix-huit mots froids et orgueilleux, chacun est comme un coup de poignard. Je m’effondre devant la dureté de sa phrase, cette manière méprisante de « faire savoir » qu’il « met fin à la vie commune qu’il partageait avec Valérie Trierweiler »…
Je me lève et pars en hurlant :
– Vas-y, balance-le ton communiqué si c’est ça que tu veux.
Il tente de me rattraper, de me prendre dans ses bras.
– On ne peut pas se quitter comme ça. Embrasse-moi.
Il me propose même que nous passions la dernière nuit ensemble… Je me dégage avec force, je pars sans me retourner, le visage inondé de larmes.
J’apprendrai plus tard qu’il aura fallu trois conseillers officiels, entre deux piles d’affaires courantes à expédier, pour rédiger ma répudiation, l’acte de décès de notre amour. Nous ne sommes pas toujours maîtres de nos sentiments. Nous sommes tombés amoureux l’un de l’autre alors que nous n’étions pas libres. Il ne s’agissait pas d’un égarement. Alors pourquoi tant d’inhumanité? De violence? Il a désormais les plus hautes responsabilités. S’il ne peut y avoir d’art, qu’il y ait au moins la manière.
Je dois rejoindre mes officiers de sécurité qui m’attendent à la voiture. Je pleure, comme rarement j’ai pleuré. J’essaie de me cacher derrière un arbre pour qu’ils ne me voient pas dans cet état. L’un des maîtres d’hôtel me glisse un paquet de mouchoirs. Mais c’est moi, le kleenex qui vient d’être jeté à l’instant.
Je prends sur moi, je retrouve l’équipe. J’arrive seulement à leur dire que nous retournons rue Cauchy. Personne n’ose me dire un mot. Nous venons de passer le pont Alexandre-iii, quand je reçois un message de mon bourreau. Il vient d’actionner la guillotine et m’envoie un mot d’amour : « Je te demande pardon parce que je t’aime toujours ».
Cela ne fait que redoubler mes larmes. Alors pourquoi ? Est-il sincère ou est-ce encore une trace de sa lâcheté?
Il nous faut peu de temps pour rejoindre l’appartement de la rue Cauchy. Dans l’ascenseur, Alexandre, l’officier de sécurité qui me suit, a l’air aussi désespéré que moi en me voyant dans cet état. Il s’inquiète, me demande si je vais tenir le coup.
– Oui, ça va aller.
Surtout ne pas allumer la télévision, ni la radio. Les messages commencent à affluer sur mon téléphone. Je les regarde à peine. La nouvelle se répand comme la poudre. Je n’ai pas conscience qu’elle est en train de faire le tour du monde, comme je n’ai pas vu les unes de la presse internationale après les photos du scooter puisque j’étais à l’hôpital.
Je ne veux pas entendre, il faut que je me protège de cette tempête médiatique.
Ce n’est pas la première bourrasque que j’affronte, mais c’est la pire de toutes et je ne suis pas très vaillante. Je fouille parmi la collection de dvd. Je n’ai qu’une idée, me mettre au lit et emmener mon esprit ailleurs. N’importe où pourvu que cela m’éloigne de la réalité.
J’attrape le film Elle s’appelait Sarah. Il y a longtemps que je voulais regarder ce long métrage de Gilles Paquet-Brenner, tiré d’un roman de Tatiana de Rosnay. L’histoire d’une journaliste américaine qui enquête sur le Vel’ d’Hiv, et remonte le fil de la vie d’une petite Sarah.
Il est à peine plus de 20 heures, je suis sous ma couette sans la moindre envie de dîner. Mon ordinateur sur les genoux, je regarde ce film tragique. Je me coupe du monde et je ne sais plus pourquoi je pleure, le film ou ma vie. À la dernière image, je suis vidée, épuisée. Je mesure ce soir-là l’expression « pleurer toutes les larmes de son corps ».
Comme des insectes qui se cognent à la vitre, des pensées vont et viennent dans ma tête. Comment a-t-il pu me faire ça? Si nous nous aimons toujours, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je pars le lendemain en Inde. Je me raccroche à cette perspective comme une naufragée à sa bouée.
En arriver là?
Que s’est-il passé pour que nous nous soyons éloignés ainsi l’un de l’autre en si peu de temps? Le pouvoir a agi comme un acide, il a miné notre amour de l’intérieur.
En mai 2014, quelques mois après la séparation, une «réplique» de la douleur…
A mon réveil, je consulte les dépêches, comme à mon habitude. Je découvre, pétrifiée, sa déclaration concernant ce que la presse appelle le « Gayetgate ». À la question « Avez-vous été digne? », il répond :
– Vous ne pouvez pas ici laisser penser que je n’aurais pas été digne. Jamais je ne me suis livré à je ne sais quelle facilité, confusion, jamais je n’ai été dans une forme de vulgarité ou de grossièreté.
François Hollande est un politique, maître de ses paroles. Il avait préparé sa réponse.
Je suis dévastée par ses mots. Depuis notre séparation, il y a déjà trois mois, il me supplie de reprendre notre histoire, notre vie commune. Il a cherché à me voir. J’ai accepté. Il m’a proposé de dîner dans ce restaurant que nous aimions. J’ai dit oui.
Depuis trois mois, il m’assure s’être trompé, s’être lui-même perdu, il répète qu’il n’a toujours aimé que moi, qu’il a très peu vu Julie Gayet. Quinze jours après le communiqué à l’AFP, il me disait regretter la séparation. Quatre jours encore et il me parlait de nous retrouver. Il me fait porter des fleurs à tout bout de champ, y compris lorsque je suis à l’étranger. Il me fait des déclarations passionnées. J’y ai parfois été sensible. Son retour de flamme m’a troublée. La porte s’est sans doute entrouverte et j’ai eu un instant la tentation de céder à nouveau. Mais elle se referme très vite. J’ai retrouvé ma liberté et elle me plaît, je n’arrive pas à lui pardonner. La rupture a été trop brutale.
Cette phrase qu’il vient de prononcer à la radio, pleine de négations comme des aveux dissimulés, ces mots qui n’expriment pas une once de regret, me font saigner à nouveau.
François veut me récupérer mais, tout à son orgueil, il n’est même pas capable d’exprimer le début d’un remord. Pas le moindre début de réparation publique. Il me l’avait pourtant promis. Prononcer mon prénom est toujours aussi difficile pour lui devant les autres. « Digne », a-t-il dit? Dignes, les photos volées d’un Président à l’arrière d’un scooter et gardant son casque à l’intérieur de l’immeuble pour ne pas être reconnu?
Digne, son indifférence, ma mise à l’écart à l’hôpital, les instructions venues d’en haut pour que l’on augmente ma dose de calmants ? Digne encore ce communiqué de répudiation, froid comme un décret, dicté à une journaliste ?
Je ne sais pas s’il mesure la déflagration qu’il provoque en moi avec cet entretien. Je suis accablée comme au jour le plus noir de notre rupture. La lame est enfoncée encore plus profondément. L’amertume et la colère creusent la plaie.
42
Je croyais être parvenue à me reconstituer, durant ces derniers mois. Son déni me plonge dans le plus grand désarroi. Me voilà à nouveau en larmes, alors que dans moins d’une heure je dois retrouver l’équipe du Secours populaire pour aller visiter l’école de Rivière froide. J’étais parvenue au bout du monde à l’oublier et je suis rattrapée par le chagrin.
Je lui envoie quelques sms pour lui dire ce que je pense. Il me répond qu’il ne comprend pas, qu’il trouvera les mots justes la prochaine fois. Toujours la prochaine fois… Combien de promesses m’a-t-il faites, jamais tenues? Les mots, les paroles n’ont-ils aucune valeur pour lui?
Ce matin, il vient de me perdre définitivement.
Epilogue
François m’a fait tant de mal. Et pourtant il me manque parfois, c’est vrai. Le passé me manque, notre amour, notre passion insouciante me manque, les heures où tout semblait facile, où les couleurs étaient plus fortes, l’air plus léger. Mais le passé ne revient jamais.
Ou alors en bouffées violentes qui m’anéantissent: le passé ne veut pas mourir, surtout celui d’avant l’Élysée, lorsque François était un autre. Ou plutôt, lorsqu’il était lui.
Ses messages me parlent d’amour. Il m’écrit que je suis toute sa vie, qu’il ne peut rien sans moi. Est-il sincère ? Croit-il ce qu’il écrit ? Ou suis-je le dernier caprice d’un homme qui ne supporte pas de perdre ? Il m’écrit qu’il me regagnera, comme si j’étais une élection. Je le connais si bien maintenant : s’il parvient à me reconquérir, à rééditer l’impossible, il se dit peut-être qu’il pourra également regagner le coeur des Français, alors qu’il est le Président le plus impopulaire de la Ve République.
En moi, la confiance est morte. Pour les Français, c’est bien sûr une toute autre affaire.
(…) Nous sommes le 4 juillet 2014. Vingt-neuf. J’ai compté vingt-neuf sms hier. Tout au long de son vendredi de président de la République, malgré son emploi du temps minuté, François Hollande m’a envoyé vingt-neuf textos. Je m’en veux de lui avoir répondu et de relancer ainsi la machine infernale. Nous tournons en rond, comme chaque jour. Il me dit toujours la même chose, qu’il veut me retrouver, qu’il nous faut recommencer. Je lui réponds toujours la même chose, qu’il m’a mise à terre, et n’a rien fait pour me relever.
97
François continue à me jurer qu’il n’a jamais revu Julie Gayet depuis janvier ni eu le moindre contact avec elle. Que lui dit-il à elle ? Que lui écrit-il ? Que lui disait-il de moi pendant leur liaison clandestine ? Qu’il ne m’aimait plus ? Que j’étais invivable ? Que notre relation était platonique ? En matière de lâcheté, les hommes infidèles se ressemblent tous et les hommes de pouvoir se confondent.
Et les derniers mots bouleversants de Valérie Trielerweiler, datés du 31 juillet 2014…
Le temps est venu de clore ce récit, écrit avec mes larmes, mes insomnies et mes souvenirs dont certains me brûlent encore. Merci pour ce moment, merci pour cet amour fou, merci pour ce voyage à l’Élysée. Merci aussi pour le gouffre dans lequel tu m’as précipitée. Tu m’as beaucoup appris sur toi, sur les autres et sur moi-même. Je peux désormais être, aller et agir, sans craindre le regard d’autrui, sans quémander le tien. J’ai envie de vivre, d’écrire d’autres pages de cet étrange livre, de ce singulier voyage qu’est une vie de femme. Ce sera sans toi. Je n’ai été ni épousée, ni protégée. Puis-je seulement avoir été aimée autant que j’ai aimé.
 Le Reporter.ma Actualités et Infos au Maroc et dans le monde
Le Reporter.ma Actualités et Infos au Maroc et dans le monde 
























